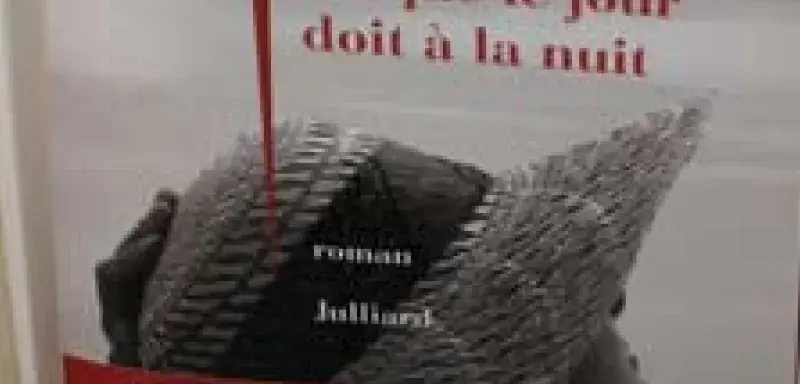La face cachée du dernier roman de Yasmina Khadra: "Ce que le jour doit à la nuit"(1)
 A ne voir dans le dernier roman de Yasmina Khadra que le récit d'une douloureuse confrontation de deux communautés qui se déchirent à cause de leur attachement viscéral à un même pays, on risque de le réduire à n'être qu'un texte-prétexte pour faire passer un message, et par là-même, de méconnaître sa valeur littéraire.
A ne voir dans le dernier roman de Yasmina Khadra que le récit d'une douloureuse confrontation de deux communautés qui se déchirent à cause de leur attachement viscéral à un même pays, on risque de le réduire à n'être qu'un texte-prétexte pour faire passer un message, et par là-même, de méconnaître sa valeur littéraire.
Une lecture qui s'inscrit dans une perspective littéraire s'avère dès lors indispensable puisqu'il s'agit avant tout d'une œuvre de fiction. Elle permet de dégager la vision de l'auteur, non pas celle liée à la seule narration mais celle qui organise le roman dans sa globalité.
Ainsi, dans cette fiction autobiographique intitulée: Ce que le jour doit à la nuit (1), le lecteur est a priori invité à suivre le fil d'un long récit de vie - dans ses grandes étapes : l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et la vieillesse d'un narrateur- avec, pour toile de fond, la situation coloniale en Algérie puis la guerre de libération et l'accession à l'indépendance.
Pourtant ce qui donne au roman sa complexité est à chercher ailleurs que dans cette apparente linéarité.
Il y a d'abord l'articulation de deux temporalités différentes: le temps long du récit de vie d'un narrateur et le temps court d'un voyage qui le déclenche et le contient et dont le dévoilement survient à la fin du livre.
Cette articulation des deux temporalités est primordiale car elle fait du narrateur l'incarnation vivante et finalement réussie d'une synthèse longtemps considérée comme impossible.
Ce personnage est en effet le lieu où se cristallisent la part d'interaction et d'attachement de deux communautés pourtant vouées à s'affronter violemment tant la présence de l'une n'a signifié pour l'autre que dépossession, ruine et malheur...
Incarnation vivante d'une synthèse communautaire, le narrateur est aussi le symbole d'une dualité qui se traduit par les deux prénoms qu'il porte: Younès pour les siens et Jonas pour les Français.
En ce sens, il est exemplaire de nombre de générations qui ont vécu le colonialisme, la guerre et l'indépendance, et pour lesquelles cette dualité représente un élément constitutif d'identité, quelles que soient par ailleurs les réactions -de rejet ou d'acceptation- qu'il a pu susciter.
Younes-Jonas par sa dualité même dit la complexité de l'être sans cesse contraint à des ajustements intérieurs de forces antagonistes et souvent mis en demeure de choisir un camp alors même qu'il se sent appartenir aux deux.
D'où l'importance des thèmes exploités dans le roman: l'adoption en est un, et qui prédomine, puisqu'il conditionne tout l'itinéraire du narrateur. Celui de la pauvreté et de la misère dans l'apprentissage de la vie aussi.
D'une manière générale, on peut dire que c'est à travers l'exploitation de ces thèmes que le livre actualise les références littéraires.
Les descriptions du monde rural, de l'extrême dureté des conditions de vie font immanquablement penser au Fils du pauvre (2) de Mouloud Feraoun, au Fleuve détourné (3) de Rachid Mimouni ou encore au Premier homme (4) de Camus.
Ces références sont cependant réactivées dans un sens moins centré sur l'ascension individuelle par le moyen de l'école et plus ouvert sur l'ancrage social, compliqué qu'il est par la situation coloniale, l'engagement et la lutte pour l'indépendance algérienne.
Dans ce contexte, l'adoption prend son sens le plus positif.
En permettant à Younes-Jonas de changer de famille, elle dédramatise le récit pour en libérer la véritable substance, à savoir: l'éducation sentimentale du narrateur qui, sa vie durant, n'a pas trouvé le courage d' assumer sa passion amoureuse.
En ce sens, il incarne le plus commun des mortels confronté à des interdits sociaux et qui, lorsqu'il se décide enfin à les surmonter, découvre qu'il est trop tard...
Quant à l'adoption impliquée par l'amitié, cette autre valeur humaine, elle finit par triompher des obstacles et des conflits. En ce sens, elle ouvre sur l'universel...
(1) Yasmina KHADRA: Ce que le jour doit à la nuit, Julliard, 2008 ,
(2) Mouloud FERAOUN: Le fils du pauvre, Points, 1950
(3) Rachid MIMOUNI: Le Fleuve détourné, Stock, 1982
(4) Albert CAMUS: Le premier homme, Gallimard, 1998, posthume