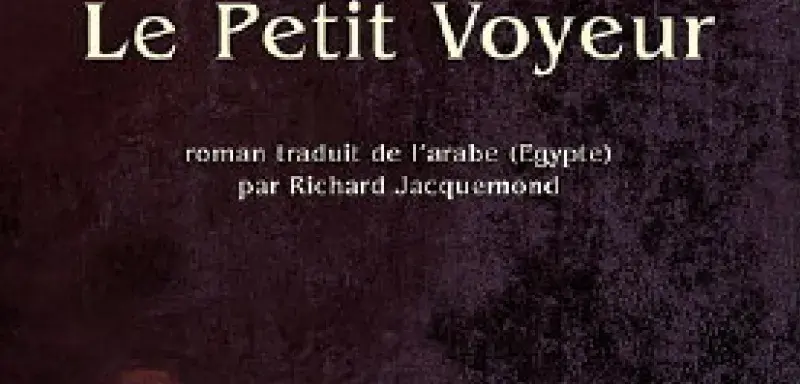"Le Petit Voyeur" (1), un Nouveau Roman égyptien
 Dans ce roman, le récit se développe selon une approche essentiellement descriptive.
Dans ce roman, le récit se développe selon une approche essentiellement descriptive.
Le "petit voyeur" est le principal spectateur de situations dont se saisit sa curiosité d’enfant, attentive à ne rien perdre d’un monde qui lui est à la fois familier mais étrange, connu mais mystérieux. Et qu'il rapporte sous la forme d'une série de scènes qui se succèdent sans discontinuer.
Dès lors, la vue est, des cinq sens, le plus déterminant pour nourrir sans cesse l’insatiable désir de capter tout ce qui se passe autour de lui. Et le lecteur ne peut que suivre le regard de cet enfant et aussi ses pas. Car ce sont eux qui, tel des supports de caméra mobile, guident en même temps le point de vue et la focale.
Le jeune narrateur s’acquitte d’une double mission : enregistrer ce qu’il voit et simultanément le transcrire sous forme de récit pour le délivrer au lecteur. Des images absorbées donc, puis restituées en mots avec précision, sobriété et objectivité.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle ce récit rappelle les successions d’indications scéniques qu’un dramaturge insère dans ses pièces en vue de leur mise en scène et de leur interprétation théâtrale.
Mais ici, elles sont prodiguées comme à rebours. Les étapes sont inversées. D’abord les scènes se jouent et sont interprétées par des personnages familiers dont le narrateur fait partie, et ensuite l’écriture en restitue les rudiments.
Le paradoxe du petit voyeur est que justement sa vue laisse à désirer.
Une scène presque inaugurale l’illustre dans une rue du Caire aux trottoirs jonchés d’étals à même le sol : « Une rangée de marchands d’objets anciens et de cireurs de chaussures. Une collection de vieilles lunettes, étalées par terre sur une feuille de journal.(…)Mon père se baisse, fouille dans les lunettes, choisit une paire, me les fait essayer. Je les prends, regarde autour de moi. J’essaie une autre paire, puis une troisième, ovale, à monture fine et dorée. Je sens que je vois mieux avec. Mon père marchande le prix et les achète. »
L’essentiel semble être dit dans cette scène : un père, dans une posture qui symbolise l’effort pour contourner le poids de l’indigence, et son fils, pour qui l’essayage de lunettes d’occasion ouvre sur le panoramique, la beauté, la perception et le confort. On croirait presque assister à une action de réglage et d’accommodation d’un instrument d’optique, d'une caméra par exemple.
A partir de là, la succession des scènes s’organise selon un mouvement proche du phénomène de la sédimentation : chacune s’inscrit après l’autre dans un ordre qui n’est pas forcément chronologique et parfois même purement arbitraire tant il ne laisse présager aucune principe de continuité narrative mais obéit seulement au double mouvement du regard et du voyeur.
Quand ils déchiffrent les espaces jusqu’à leur moindre recoin, les yeux de celui-ci explorent, arpentent, feuillettent. Et cela, sans jamais cesser leur activité lors de ses déplacements . Vue et points de vue sont inséparables comme l'est le fils toujours collé aux basques d’un père vieillissant, pauvre, solitaire mais qui semble avoir connu des périodes de vie beaucoup plus fastueuses.
D’abord intrigué par la structure très simple et parfois tronquée des phrases de description, le lecteur peut se demander où le mènera un récit qui semble ne pas en être un. Des scènes, oui, mais un principe de construction fuyant, toujours en mouvement, et surtout pas très conforme aux habitudes de lecture.
Puis, au fur et à mesure d’un développement « sédimentaire», des plans se laissent découvrir avec les logique, cohérence et cohésion qui conduisent à la plus parfaite des illusions narratives.
Là réside tout le génie de Sonallah Ibrahim, l’auteur du Petit Voyeur : avec un écriture très novatrice au plan de la forme qui rappelle celle du Nouveau Roman français, il réussit à nous faire vivre une tranche de vie à travers l’union d’un père et de son enfant tout en ouvrant sur des champs sentimentaux, humains, mais aussi historiques et politiques de l’Egypte des années 40.
De surcroît, et par intermittences tout le long de son écriture, il lève un voile qui laisse apparaître en surplomb une figure féminine privilégiée, celle de la jeune maman disparue, dernière épouse du polygame vieillissant mais encore vert. Le petit voyeur est un fin limier, jaloux par-dessus tout de l’affection paternelle, et sa quête perpétuelle le mène sur des voies qu’il n’est pas toujours, à cause de son très jeune âge, en mesure de comprendre…
Mais peu importe, la vie continue malgré les signes concrets du temps qui passe et l’essentiel pour le petit voyeur c’est que rien de fondamental ne change dans le couple qu’il forme avec son père.
(1) SONALLAH IBRAHIM: Le Petit Voyeur, Ed° Actes Sud, 2008