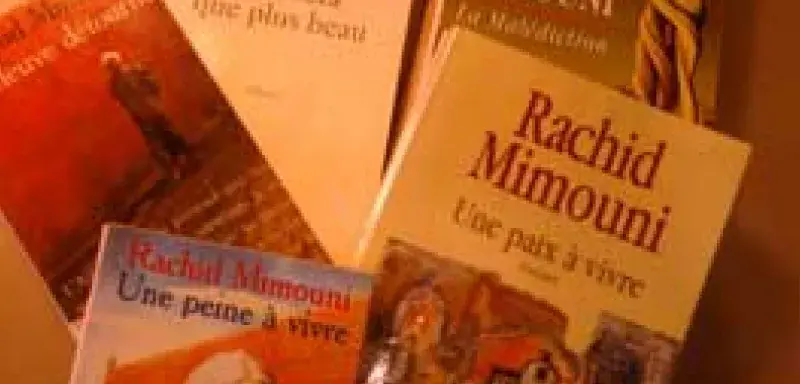Rachid Mimouni : Une œuvre majeure et plurielle

Il y a quatorze ans, le 12 février 1995, Rachid Mimouni nous quittait.
Plus vivante que jamais, l’œuvre de ce fils de paysan devenu grand écrivain, reste inlassablement ancrée à l’Algérie.
A un moment où le pays tout entier n’a pas encore fini sa lutte contre l’obscurantisme, cette œuvre nous parle, encore et toujours actuelle et subversive…
En hommage à cet écrivain, témoin lucide et inépuisable des heures les plus sombres de la folie meurtrière qui a saigné l’Algérie, un regard sur quelques-uns de ses romans…
Avec Le printemps n’en sera que plus beau (1), son premier roman, Rachid Mimouni fait revivre la période héroïque du combat d’un peuple pour son Indépendance : les héros de ce romans sont jeunes, graves, investis d’une mission essentielle.
Comme dans une tragédie antique, ils évoluent dans une trame simplifiée qui fait de l’action principale une inexorable avancée vers la mort.
La voix du poète, semblable à celle d’un coryphée, la très forte stylisation théâtrale du texte, le nombre réduit de personnages amplifient la portée symbolique de ce drame qui finit par s’incarner dans le sacrifice final de l’héroïne…
Le printemps n’en sera que plus beau intègre ainsi l’incontournable thème de l’histoire de l’Indépendance algérienne… Mais, déjà, sont posées dans ce premier roman la problématique collective du sacrifice fondateur, celles de l’amour, de l’illusion et des engagements à tenir…
Une paix à vivre(2) nous invite à suivre une tranche de la vie d’un adolescent aux toutes premières heures de l’Indépendance algérienne.
L’Ecole Normale d'instituteurs en est le cadre narratif privilégié : lieu de formation de la jeunesse de l’après-guerre, mais aussi lieu où se cristallisent de nombreux paradoxes.
Ainsi en est-il du culte de l’école cultivé par les parents alors même qu'il est contredit par leur propre inaptitude à en apprécier les acquis autrement qu’en termes de statut social : à l’exemple de Mohamed IGUER, petit berger devenu musicien mondialement reconnu, mais au génie totalement méconnu des siens, qui mourra dans une indifférence quasi-générale...
Ainsi en est-il aussi de l’ apprentissage scolaire de la citoyenneté qui, pourtant, au sein de la société, se heurte aux barrières érigées à l’expression politique (avec la répression des manifestations estudiantines, et l’encadrement bureaucratique de l’expression…) .
Ainsi en est-il enfin d'une revendication de liberté à l’égard de la pression religieuse , et qui, pourtant, tourne court dès la première mise à l’épreuve de force…
Mais au delà de cet arrière plan sociologique et politique, Une paix à vivre trouve sa dimension littéraire dans l’itinéraire poignant du personnage principal, Ali Djabri.
Pour cet orphelin de seize ans, dont les sœurs ont été décimées par la maladie, l’ignorance et la misère, dont les parents ont été déchiquetés par les bombardements de l’armée française, il reste une échappatoire à la folie qui le menace : comprendre.
Comprendre la logique meurtrière qui a ravi à son affection Fatma, sa sœur cadette, sa préférée, puis ses trois autres sœurs ; comprendre pourquoi « un déluge de feu s’était abattu sur (son) douar, dévastant les vieilles mechtas et poursuivant les petites fourmis humaines qui fuyaient à travers champs »…
Le poids trop douloureux de la mémoire fait d’Une paix à vivre une impossible quête de l’oubli : et il finit par être mortifère…
Le Fleuve détourné(3) amorce un tournant décisif dans l’écriture de Mimouni.
La mise en évidence de l’absurde politique et social s’effectue par un entrelacement de deux itinéraires et un traitement particulièrement complexe de la temporalité romanesque.
Le premier itinéraire est collectif : il concerne un groupe d’hommes considérés comme subversifs par une administration omnipotente qui entend bien les neutraliser au moyen d’une castration systématique.
Le second itinéraire est individuel : un ancien moudjahid, figurant comme martyr-chahid sur la liste de noms d’un monument aux morts, revient pourtant un jour, sur les lieux de son passé, à la recherche de son épouse et de son fils.
Un seul et unique narrateur - sans nom – pour deux quêtes entrecroisées : un mort vivant qui, de mémoire perdue en mémoire retrouvée, observe avec effroi l’état de délabrement moral de son pays.
Cette polarité du récit décuple les possibilités de points de vue et c’est ainsi que, substituant au poids du passé et de l’histoire le poids non moins oppressif du présent et du vécu, Rachid Mimouni inaugure une thématique nouvelle : la thématique existentielle.
Celle-ci marquera l’ensemble de ses romans à venir. Elle est exprimée avec angoisse par ses différents personnages, dont celui de l’Ecrivain, à travers cette question fondamentale : « Que sommes-nous ? »
Et, en effet, lorsque l’injustice, le viol, la dépossession habitent un corps social, il y a trahison de la mémoire, et c’est alors « en nous-même qu’il faut chercher l’origine de la trahison ».
Dans le Fleuve détourné, Rachid Mimouni pose les jalons d’une orientation radicale de son écriture, renforcée par cette sorte de mise en écho interne de ses romans : en effet, on y trouve déjà formulés et même réitérés les mots de « malédiction » et de « peine à vivre » qui deviendront les titres de ses romans suivants, tandis que le thème obsessionnel du viol et de la bâtardise constituera la substance principale de Tombéza(4).
Tombéza se déroule dans ce temps aussi infini que bref qu’est le temps d’une agonie.
Au seuil de sa mort, le personnage Tombéza déroule le film de son horrible vie qui, inéluctablement, va se transformer en destin.
Il se saisit alors du pouvoir de raconter mais aussi de celui de parler : parler sans peur, sans complaisance, mais avec une hargne, un écoeurement et une inextinguible révolte, d’une société qui a fait de lui non seulement le produit d’un viol mais aussi le coupable de sa bâtardise.
Tout comme sa mère qu’il n’a pas connue, sa mère, adolescente d’à peine seize ans lorsqu’elle fut non seulement violée par un inconnu mais aussi, et à cause de ce viol, battue à mort par son propre père.
A travers le prisme d’une société qui condamne ses victimes, les déclare coupables d’avoir subi le viol et les punit pour ce même motif, Rachid Mimouni impose une autocritique sociale rigoureuse qui débouche sur l’idée que l’individu ne peut qu’accuser les traits de la société qui l’englobe.
Ici, l’hypocrisie sociale et la lâcheté sous toutes ses formes : celle du tabou sexuel et de la misogynie qui offre au violeur une totale impunité, celle du tabou religieux qui permet à l’ignorance d’embrigader la foi et le savoir, celle du tabou de la bâtardise qui désigne le bouc émissaire …et la liste est longue.
Une Peine à vivre (5) exploite le même motif d’un personnage au seuil de sa mort.
Ce roman présente l’interminable râle d’un homme qui a su user de toute les compromissions, les lâchetés, les violences et les servilités qu’une société recèle à l’usage de qui veut bien s’en servir sans vergogne et sans scrupule pour gravir un à un les échelons qui mènent au faîte du pouvoir.
Un râle en effet long et interminable puisque c’est celui du narrateur principal qui n’est autre que le tout puissant Maréchalissime, ligoté contre le mur du polygone en face d’un peloton d’exécution formé de ceux-là mêmes qui l’ont adulé et l'ont vénéré jusqu'au moment de sa disgrâce.
Les problématiques du pouvoir et de la dictature développées dans ce roman sont placées par l’auteur sous le double exergue de Nietzsche et de Camus.
Nietzsche, dont Mimouni a choisi cette citation, ô combien prémonitoire : "Les hommes forts, les vrais maîtres retrouvent la conscience pure des bêtes de proie ; monstres heureux, ils peuvent revenir d’une effroyable série de meurtres, d’incendies, de viols et de tortures avec des cœurs aussi joyeux, des âmes aussi satisfaites que s’ils s’étaient amusés à des bagarres d’étudiants."
Et Camus : « Nous portons tous en nous nos bagnes, nos crimes et nos ravages. Notre tâche n’est pas de les déchaîner à travers le monde. Elle est de les combattre en nous-mêmes et dans les autres".
Entre la bête immonde tapie en chacun de nous et une destinée plus humaine, le Maréchalissime, personnage dictateur n’a pas su faire le choix de l’amour et du bonheur…
Quelques mois avant sa mort, Rachid Mimouni publiait son dernier roman, la Malédiction (6), dédié à son ami écrivain Tahar Djaout, assassiné lâchement par la horde intégriste à l’instar de nombreux autres intellectuels algériens.
Avec comme toile de fond les événements (occupations et manifestations intégristes), qui ont marqué Alger, à la veille des élections législatives de 1991, la Malédiction dessine l’incroyable cheminement qui peut conduire un homme à haïr son propre frère au point de le sacrifier à la furie intégriste.
Durant la décennie 90, la réalité, hélas, a, en horreur, dépassé la fiction .
Mais si la littérature ne se laisse pas réduire à cette macabre comparaison, c’est que finalement Rachid Mimouni dans son geste créateur a accompli sa fonction sociale d’écrivain pour avoir, ainsi qu’il se l’était proposé, tendu à la société algérienne le miroir qui lui renvoie, aujourd’hui plus que jamais, sa propre image…
(1)Rachid Mimouni : Le printemps n'en sera que plus beau, ( 1 re éd° : ENAL - Alger 1978 et 1988 - 2 e éd° : Stock, France 1995 - 3 e éd° : Pocket 1997
(2)Rachid Mimouni : Une paix à vivre, ENAL, Alger, 1983
(3)Rachid Mimouni : Le fleuve détourné, Ed° Laffont, 1982
(4)Rachid Mimouni : Tombéza, Ed° Stock, 1984
(5)Rachid Mimouni : Une peine à vivre, Ed° Stock, 1991
(6)Rachid Mimouni : La malédiction, Ed° Stock, 1999